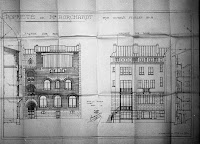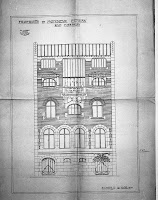Le texte polémique d’Arsène Alexandre n’aurait sans doute pas eu le succès qu’il remporta s’il n’avait pas été lu par Paul Planat, directeur de la revue d’architecture “La Construction moderne”, qui y répondit, pratiquement point par point, dans “Actualités”, sa chronique hebdomadaire, parue dans le numéro du 15 septembre 1900 (p. 589-591).
Après avoir illustré le texte du “Figaro” avec quelques édifices contemporains, alors parfaitement visibles à Paris, j’ai tenu à accompagner celui-ci avec des images de la célèbre Casa Battlo de Gaudi, construite sur le Passeo de Gracia, à Barcelone. Certes, cette maison singulière est beaucoup plus tardive (1908 !), mais sa structure même semble répondre idéalement aux craintes de tous les journalistes de l’époque, mettant en pratique les frayeurs annoncées. En tout cas, je ne connais pas beaucoup d’édifices ayant réalisé avec autant d’audace et de virtuosité l’art de “l’os de mouton” !
Monsieur Planat... c’est maintenant à vous :
“Lorsqu’apparut pour la première fois le Modern Style, qui, moitié anglais et moitié belge, excita dans une partie du public français un très vif engouement, de non moins vives protestations s’élevèrent de tous côtés. Ici même la Construction Moderne s’est fait l’écho de ces sentiments très divers. Philosophiquement nous avions conclu : Il ne faut pas condamner, dès le début, un effort vers l’originalité, vers la nouveauté ; que les premiers résultats obtenus nous plaisent ou non, nous devons encourager ces tentatives ; lors même qu’elles ne tiendraient pas tout ce qu’elles promettent, il en peut sortir quelques germes vivaces qui seront la semence de l’avenir.
Qu’il y eût beaucoup à critiquer, cela n’est pas impossible ; mais on a toujours tort de chercher à faire avorter les innovations ; c’est peut-être étouffer dans l’œuf une conception destinée à devenir féconde. Il n’y a qu’un parti raisonnable à prendre : Laissons le Modern style suivre le cours naturel de ses destinées sans y mettre obstacle. Nous verrons bien où elles le conduiront. Ce qui mérite de vivre subsistera ; ce qui n’est pas viable succombera tout naturellement.
A l’Exposition même on le voit très clairement : Il y a bien deux sortes de Modern Style ; l’une d’inspiration anglaise, l’autre d’origine belge ; l’une et l’autre très influencées par le japonais qui est pourtant bien démodé aujourd’hui ; l’une, plus tranquille, qui cherche son mérite dans de petits détails minutieux ; l’autre beaucoup plus exubérante.
Les Anglais ont longtemps aimé la coutellerie compliquée où le même objet servait à toutes sortes de fins ; ils ont dépensé une rare ingéniosité à combiner des meubles portatifs qui pouvaient être à volonté un pliant pour s’asseoir, un parapluie, un ain de siège ou une tente-abri. Leur conception mobilière s’est beaucoup simplifiée depuis ; pour eux, l’étagère est maintenant le prototype du meuble quel qu’il soit. Une cheminé, par exemple, sert à chauffer ; ou, tout au moins, il est bon qu’elle en donne l’illusion ; mais elle n’est plus que le prétexte qui donne naissance à des étagères pour bibelots, sur les côtés, au dessus, en haut et en bas.
La table est dans le même cas : Autrefois elle avait des pieds, des tiroirs au besoin ; aujourd’hui les pieds sont des étagères ; sur la tablette, à droite et à gauche, se dressent encore des étagères ; en arrière, en ménageant la place strictement nécessaire pour les jambes de l’opérateur, les fonds sont aussi de nouvelles étagères.
Les fauteuils, les sièges sont eux-mêmes surmontés de petites étagères. Les petits compartiments qui composent celles-ci ne sont conformes au nouveau programme qu’à la condition d’être ramenés aux proportions les plus réduites possibles. On n’y peut loger que de minuscules petits pots, des bouchons de carafe placés en équilibre instable, des verres fragiles grands comme des dés à coudre et autres menus objets.
Evidemment l’idéal de l’esthétique moderne se résume en cet axiome : L’exquise pureté dans l’infiniment petit ! - L’application a de nombreux inconvénients.
Si, encore, ces innombrables compartiments étaient logés à peu près d’aplomb, le regard pourrait se rassurer un peu et leur attribuer une certaine stabilité, plus idéale que réelle, mais qui donnerait à l’esprit une sorte de satisfaction. Malheureusement l’influence japonaise dont nous parlions tout à l’heure a laissé des traces visibles. On sait que l’art japonais a horreur de toute symétrie ; c'est même par là qu’il nous a séduits, délassés de la régularité traditionnelle, amusés pendant une vingtaine d’années.
Le style anglais, en quête d’originalité, n’a eu garde de négliger ce moyen commode de sortir de l’ordinaire ; aussi, à l’instar des petites boîtes japonaises, les compartiments d’étagères sont-ils disposés en marches d’escaliers contrariés.
L’impression finale est quelque peu déconcertante. Sans doute tout ce mobilier, travaillé dans des bois rares, précieux ou même inédits, avec un soin méticuleux, a le mérite de ne pas être encore tombé dans la contrefaçon de pacotille, - ce qui, malheureusement ne tardera guère. - Mais on éprouve une réelle inquiétude à soupçonner ce qui arriverait si un personnage quelconque venait à s’appuyer sur cette cheminée, ou même à s’en approcher trop brusquement ; à s’asseoir sans précautions infinies dans ces sièges, souvent peu commodes, d’ailleurs. On songe avec effroi à la pluie de bibelot qui s’ensuivrait inévitablement sur la tête du visiteur et au grand dam de leur légitime propriétaire.
***
Il n’en est pas moins vrai que cette recherche de bois rares, laissés sous leur aspect naturel, que cette délicatesse, ce fini de la main-d’œuvre, pourront inaugurer un progrès obtenu au moyen d’éléments nouveaux. Peut-être préparent-elles, comme il arriva à la fin du siècle dernier, un retour à des formes très simples, très pures, sans toutefois tomber dans la froideur et la roideur du style Empire, et sans copier trop aveuglément les formes Louis XVI.
A quoi pourrait conduire le style l’autre Modern Style, celui qui est né de l’influence belge ou allemande ? On le discerne moins aisément. Partant de certains paraphes japonais qui sont amusants comme jets du pinceau lancé sur le papier de soie, la caractéristique de cet art nouveau est le zig-zag, le coup de fouet appliqué à l’ébénisterie, à la menuiserie, et à la serrurerie indistinctement. Il est certain que, dans ces trois corps de métier, l’introduction de cet élément calligraphique a constitué une véritable nouveauté.
Nous n’en saisons pas très bien le charme ; il ne faut cependant pas le nier avec entêtement, puisqu’il a effectivement séduit les nombreuses personnes qui tiennent à se signaler par un goût spécial, particulièrement raffiné et, surtout, dépassant la mesure des esprits ordinaires.
Cet engouement durera-t-il longtemps encore ? Il y a lieu d’en douter. Faisant la tache d’huile, il pénètre maintenant dans quelques pays qui sont en retard de quelques années ; mais, comme les nuées d’orage, tandis qu’il progresse d’un côté, il se retire lentement, mais sûrement de l’autre.
La critique d’art elle-même, si enthousiaste de toutes les nouveautés et volontiers éprise de l’excentricité, commence à dire comme l’Ours de la fable : Otons-nous, car il sent.
Peut-être cette lassitude qui se laisse apercevoir sera-t-elle salutaire à cette variété du Modern Style, en lui faisant voir que le serpentin ne suffit pas à créer un art bien vivace. Ses promoteurs ont la passion de l’originalité, passion très louable en soi et fort utile ; ils avaient cru, encouragés par une fraction importante du public, avoir du premier coup transformé et rénové l’art. Il apparaît que, s’ils ont donné une secousse, ils n’ont pas encore mis en mouvement l’énorme machine si lourde à mettre en route. Ils seront donc contraints de chercher, et peut-être de trouver plus et mieux. A ce moment le service rendu par eux sera d’un prix très réel.
Voici donc comment s’exprime maintenant la critique d’art à ce sujet. C’est à M. Arsène Alexandre, du Figaro, que nous empruntons ces observations, justes sans dote, mais sévères à coup sûr.
“Nous pouvons, dit-il, en parler librement, maintenant que l’on ne peut plus craindre de faire du tort, dans l’attribution des récompenses, aux architectes, céramistes, ébénistes et tapissiers, étrangers ou français, qui le pratiquèrent si largement. Ils ont assez de talent pour faire autre chose, et ils doivent en être les premiers fatigués... Vous savez de quoi je veux parler : de ces lignes à la fois violentes et dépourvues de signification qui combinent la grâce des articulations d’un squelette avec le charme profond des serpentins agités par le vent.” - L’os de mouton et la nouille seraient, d’après lui, les éléments caractéristiques et générateurs de ce Modern Style.
L’un et l’autre restèrent, pendant des siècles, sans aucune application artistique.
Quand l’os du mouton était entouré d’un gigot, il trouvait évidemment un emploi assuré ; la nouille trouvait aussi des applications utiles, qui n’étaient nullement à dédaigner. Mais ce sont là des emplois proprement culinaires, où l’art n’a évidemment rien à voir. Il était réservé au Modern style de découvrir leur haute valeur esthétique.
Ce fut toute une révolution, car l’os et la nouille, séparément ou conjointement, nous apportaient à la fois le principe constructif et le principe purement décoratif ; ils se prêtaient à de multiples combinaisons d’une rare variété. Dans le genre simple et dans la période primitive, l’os de mouton fournissait l’élément solide, accusant une construction rigide, tandis que la nouille, en sa souplesse et ses molles ondulations, apportait à la décoration des formes tout à fait inédites. Mais bientôt, par un de ces raffinements exquis, produits d’une décomposition savante, que savent concevoir les esprits délicieusement blasés, ce fut la nouille gélatineuse et tremblante, affaissée sous son propre poids, qui devint l’élément constructif du meuble, de la ferronnerie artistique, tandis que l’os devenait décoratif à son tour. De là des effets incontestablement inattendus et résolument nouveaux.
Toute cette transformation esthétique, et les résultats qu’elle engendre, sont décrits, par M. Arsène Alexandre, avec une scrupuleuse exactitude que nous craindrions d’altérer par le moindre commentaire ; aussi nous contenterons-nous de citer en toute fidélité :
“Ce que la céramique moderne, ou du moins une certaine école, a consommé de tibias, d’omoplates, de cols du fémur, d’os iliaques est effrayant. D’autre part les ébénistes nous ont gratifiés de sièges, d’étagères, de dressoirs, de lits qui donnent l’impression que l’on se repose, que l’on mange, que l’on dort sur les objets d’un musée d’archéologie comparée, cependant que sur les murs se déroulent lentement des intestins dévidés. Cela se sauve, se déguise plutôt, par la beauté des matériaux employés : les ossements sont taillés dans les bois précieux, susceptibles du plus beau poli ; les vers solitaires multicolores sont des applications d’étoffes soyeuses ou de métaux exquis, tels que l’étain et le cuivre les plus purs. La première impression était de netteté et de simplicité, et nous nous sommes trouvés peu à peu suppliciés sans nous en apercevoir, - mais vous n’ignorez pas qu’il est des supplices qui commencent très bien.”
***
D’où vient cette absence d’originalité vraie, malgré tant d’efforts sincères et consciencieux, que n’a pas encore couronnés un succès définitif ? M. Arsène Alexandre en donne une explication que nous tenons aussi à reproduire, parce qu’elle est exacte en grande partie, bien qu’elle appelle quelques restrictions.
Sans doute, dit-il on était arrivé à lasser le public avec des pastiches, plus ou moins fidèles, de tous les styles connus, et il devenait nécessaire de sortir de ces répétitions. Que fallait-il faire ? Selon lui, il eût fallu revenir, une fois de plus, à la source inépuisable, qui est tout simplement la nature même.
“Les beaux artisans des âges qui ont précédé le nôtre étudiaient la nature avec un sentiment profond et ingénu. Puis ils l’interprétaient, sans la copier littéralement, lorsqu’il s’agissait de créer une œuvre. Tous nos grands styles, le roman, le gothique, celui du XVIIe siècle et celui du XVIIIe ont l’observation de la nature pour point de départ et son interprétation pour but. Ceux de notre siècle qui ont recopié ces nobles et logiques formules se sont dispensés d’interroger la nature à leur tour ; de là leur mollesse et leur pataugeage. Mais ceux qui avaient l’horreur légitime de ces répétitions défigurées et l’excellente ambition de créer du nouveau sont tombés dans l’erreur de ne pas regarder la nature davantage. Il semble qu’ils aient pris pour modèles les circonvolutions mêmes de leur cerveau, au lieu des images que ces replis reçoivent, conservent et transmettent.”
Lorsqu’on parle de peinture, de sculpture, il n’y a pas le moindre doute que l’artiste doit, avant tout, s’inspirer de la nature ; non pas pour en reproduire les aspects avec la fidélité dite photographique, qui est fausse à tant d’égards ; mais pour l’interpréter, comme on dit ; c’est-à-dire pour arriver à rendre plus saisissante l’impression qui s’en dégage.
Si l’on parle d’architecture, il est exact encore que la partie décorative, ornementale de cet art trouve des ressources infinies, en même temps qu’une originalité san cesse renouvelée, dans l’étude de la nature. L’art gothique l’a fort bien compris et en a tiré un parti excellent.
Si, de la décoration, nous passons à l’architecture proprement dite, aux principes constructifs qui sont l’essence même de chaque style, quel rôle pourrait bien jouer l’étude de la nature ? Puisque le gothique est cher, nous sans raisons, aux critiques d’art, nous demanderons : En quoi le voûte sur diagonaux ; en quoi l’arc-boutant - puisque ce sont les caractéristiques fondamentales de cet art - sont-ils empruntés à la nature ? En quels lieux nous a-t-elle donné des exemples de ces dispositions, très rationnelles à coup sûr, mais qui n’en sont pas moins sorties, armées de pied en cap, de l’intelligence humaine.
Allons plus loin, et venons au mobilier, puisque c’est là surtout le terrain où pousse et s’épanouit le Modern Style. La nature nous offre-t-elle quelque part le moindre modèle de table, de cheminée, de fauteuil ou de canapé ? Nous présente-t-elle des formes directement et logiquement applicables à une commode ou à un buffet ?
On a raison de répéter sans cesse aux artistes ce mot : Nature. Encore n’en faudrait-il pas abuser et le faire intervenir là où il n’a que faire. La nature a la grâce, la variété et une impeccable logique ; aussi est-elle toujours bonne et utile à contempler. Mais l’homme s’est créé des besoins, auxquels la nature n’avait jamais songé à satisfaire ; c’est à lui d’imaginer des solutions appropriées, par des procédés qu’il tire uniquement de son cerveau. Ces procédés doivent être logiques, cela va de soi, sans quoi il n’y aurait que mécomptes ; mais ils n’ont nulle parenté avec ceux de la nature, si ce nest cette commune logique qui est le lien de toutes choses existantes.
Aussi ne voyons-nous pas très nettement comment ni pourquoi les menuisiers, les serruriers, les ébénistes “doivent avoir l’observation de la nature pour point de départ et son interprétation pour but” ; nous ne voyons pas très clairement non plus, à part quelques ornements accessoires, comment ils en déduiraient la forme, le galbe, la disposition d’un meuble.
A quoi M. Arsène Alexandre répond : “Dans les écoles civilisées, comme dans les barbares, l’ornement le plus arbitraire en apparence est un monogramme des êtres, des astres, des dieux, des phénomènes de la nature.”
Cette observation est peut-être vraie. Peut-être, comme le veut l’écrivain, peut-on retrouver dans un crochet de gâble gothique, dans un coffret du Japon, dans la fleurette d’un tissu ou d’un papier peint, les astres, les dieux et quelques phénomènes de la nature. Mais il y faut une perspicacité qui n’est pas accordée à tout le monde ; et nous devons confesser une pauvreté d’imagination qui ne nous permet pas d’y découvrir d’aussi rares trésors.
***
Le Modern Style, lui, n’aurait pas cette propriété bien remarquable : “Quelles idées évoquent les dossiers grêles et renflés, les supports contournés de nos meubles, les lanières et les virgules de nos murailles ? - Pas d’autres que celles d’un branchage qu’on peut casser comme du verre, et de coups de fouet tumultueux décrochés par un charretier névropathe.”
Mais surtout, et c’est là le dernier et non moins grave reproche que lui adresse M. Arsène Alexandre : Ces formes soi-disant nouvelles, et si peu expressives, ont le tort d’être indistinctement employées pour un salon français, pour une salle à manger allemande, un cabinet de travail belge, un boudoir scandinave, quelles que soient les différences de races, de langage, d’esprit, d’aspiration.
Aussi l’auteur conclut-il - en termes sévères, trop sévères même si le moment n’était venu de réagir contre des erreurs trop prolongées et qui tardent trop à se transformer en vérités : Au fond, tout cela “est simplement un mauvais genre que nous donnons, ainsi qu’on voit d’honnêtes femmes, parfois, farder outrageusement leur peau fraîche et affecter des airs cascadeurs, pour souffler aussitôt ce qu’elles ont allumé.”